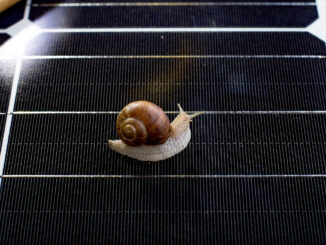Le soleil nous fournit chaque jour bien plus d’énergie que nous ne pourrions jamais en consommer.
Que nous devions en tirer parti est aujourd’hui une évidence partagée par une large partie de la société. L’énergie solaire est sur toutes les lèvres – mais le solaire thermique, lui, semble avoir été relégué au second plan.
Texte : Linda Wachtarczyk
Autrefois fer de lance des pionniers de l’énergie solaire, cette technologie simple et à haut rendement manque aujourd’hui de reconnaissance politique, les formations se raréfient – et, selon les régions, l’autoconstruction suit des trajectoires bien différentes. Tandis qu’elle continue de fleurir en Suisse romande, elle a complètement disparu du paysage en Suisse alémanique : « Là, c’est mort – et les morts ne s’essoufflent plus », précise Pascal
Cretton de l’association Sebasol (Self Bâtir Solaire), que nous avons rencontré pour cet entretien.
Avec lui, nous cherchons à comprendre : pourquoi le solaire thermique est-il aujourd’hui en retrait, notamment sur le plan politique et culturel ? Qu’est-ce que l’autoconstruction signifie réellement – au-delà d’un simple montage « à la IKEA » ?
Interview avec Pascal Cretton
Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert l’autoconstruction solaire thermique ? Etait-ce un choix technique, politique, économique… ou tout cela à la fois ?
Politique et technique. Faire pas cher était – et est toujours – une exigence morale pour ne pas léser les gens, mais pas une obsession. C’était à Cisbat. Un cycle de conférences organisé par le LESO-PB EPFL en 1993. Jean-Marc Suter était venu y présenter le projet de fondation de Sebasol. En tant qu’objecteur de conscience et gandhien, et aussi physicien au courant des problèmes (le rapport Meadows venait d’être updaté, Georgescu-Roegen d’être traduit mais je l’avais lu avant), je ne pouvais être que concerné. Il faut savoir que les scientifiques étaient souvent plus critiques que de nos jours. Kaiseraugst, Pugwash, Alexandre Grothendieck comptaient encore. La French Theory n’avait pas recouvert Simone Weil, Ivan Illich, Günther Anders. Tchernobyl était plus présent dans les esprits qu’à présent Fukushima. Il y avait moins de dispersion narcissique. On ne déclarait pas encore à la face du monde que les Palestiniens sont des animaux. On était moins « comme d’une vitesse acquise, figés dans la prosternation » (Odysseas Elytis).
Quels sont les challenges auxquels est actuellement confronté le secteur de l’autoconstruction solaire thermique ?
Trois : l’extractivisme, la realpolitik et la logique capitaliste des affaires.
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cela ? Comment ces dimensions influencent-elles concrètement le domaine ?
L’un des défis auxquels l’autoconstruction est aujourd’hui confrontée, c’est l’environnement global dans lequel elle évolue. D’abord, il y a l’extractivisme, cette logique d’exploitation intensive des ressources naturelles, que ce soit dans les mines ou les fonds marins, souvent sans considération pour les conséquences humaines et écologiques. Ensuite vient la realpolitik, cette acceptation de faits inacceptables : les Ouïghours contraints de produire des panneaux solaires, ou les travailleurs forcés qui meurent dans les mines de cobalt ou de coltan, indispensables à nos technologies « propres ».
A cela s’ajoute le poids du capitalisme marchand, qui détourne l’énergie dite verte vers des usages absurdes ou futiles : des blockbusters numériques, des réseaux dits sociaux, des plateformes pornographiques ou des deepfakes. Quand ils ne sont pas nuisibles ou criminels : sans numérique pas de guerre moderne, ni de fascisme 2.0, qui profite pourtant de tout gain d’optimisation. Autrement dit, même l’électricité verte finit absorbée par des objectifs de civilisation mortifères qui ruinent les espoirs mis en elle.
En parallèle, on assiste à une dégénérescence progressive des compétences humaines, d’abord pratiques, puis intellectuelles – affaiblies par les écrans et les prothèses numériques qui nous entourent. La compréhension des lois fondamentales de la physique ou de l’énergie recule, y compris chez les professionnels, tenus par le marché à produire des résultats partiels qui s’opposent aux objectifs écologiques ou sociaux globaux. Ce contexte est marqué par des slogans devenus normes : « the medium is the message », « the show must go on », « you’re in the matrix now ». Le solipsisme règne, l’alternative n’existe plus, et l’on remercie presque les citoyens… pour leur inattention.
Quels sont les freins sociaux à l’autoconstruction solaire thermique ?
L’un des premiers obstacles est le mimétisme social : beaucoup ont perdu l’envie ou la capacité d’agir par eux-mêmes, préférant reproduire ce que font les autres, même si cela mène à l’impasse. A cela s’ajoute une foi dans le technosolutionnisme – cette idée que la technologie, à elle seule, finira par résoudre tous nos problèmes, sans que nous ayons à changer nos modes de vie. Or les études historiques montrent qu’ainsi il n’y a pas transition, mais accumulation. La planète étant limitée, cela génère un état de guerre qui impose de capter toutes les ressources – naturelles comme humaines – quel qu’en soit le prix. Elles sont ensuite dissipées dans la guerre menée pour ce captage. C’est donc la méthode ultime de production d’entropie. Tant que la guerre n’est pas bannie, y compris sous ses formes sociales, l’humanité n’a pas plus de chance d’éviter l’autodestruction que Betelgeuse II de ne pas devenir supernova. Que les scientifiques n’osent plus le dire ni s’opposer acte leur vassalisation ou leur inconscience. Je ne sais pas ce qui est le pire.
Enfin, il y a ce que j’appelle la mentalité d’actionnaire : vouloir obtenir un bénéfice sans effort, sans implication concrète. On préfère investir, déléguer, consommer – plutôt que participer.
Un exemple parlant ? Il a suffi de peu pour que des gens se fassent escroquer de 120 millions dans l’affaire PrimeEnergy. Cela montre qu’aussi bien dans les énergies renouvelables qu’ailleurs, une grande partie de l’humanité agit désormais comme une volaille sans tête : privée de vision, courant par réflexe dans le sens de la pente.
Qu’est-ce que l’autoconstruction solaire thermique apporte de plus qu’une simple solution technique ?
Une culture et des capacités. Elle vise l’autonomie technique et sociale, notamment grâce à la solidarité et à l’entraide entre les personnes impliquées. En se lançant dans un tel projet, on développe une compréhension des phénomènes physiques en jeu, ainsi qu’une meilleure connaissance de ses propres besoins réels, loin des discours abstraits ou des solutions toutes faites.
Mais surtout, cette démarche cultive l’amour du monde matériel, du contact direct avec les éléments, ainsi que le goût du travail bien fait, soigné et respectueux. C’est une façon de renouer avec une certaine forme de sagesse pratique et d’épanouissement personnel, qui va bien au-delà de la simple installation technique.
Quels types de compétences ou de savoir-faire sont nécessaires pour réussir une autoconstruction en solaire thermique ?
Voilà une question qui peut sembler paradoxale si on la pose comme ça, car qu’en est-il du bébé tout juste né ? Il ne possède aucune compétence à la naissance. Pourtant, personne ne s’attend à ce qu’il soit immédiatement « performant » ou autonome. Bonne raison pour éliminer tout de suite ce looser qui coûterait sinon bien trop cher à instruire, et pour un résultat qui ne passera pas ISO 140001, dirait l’entrepreneur disruptif ou la Gnômesse de St-Gall, qui a pourtant été bébé. La vérité, c’est qu’au départ, les gens peuvent n’avoir aucune compétence spécifique. Tout repose alors sur un encadrement bienveillant, de l’aide administrative et logistique, une concentration soutenue, et de la patience. C’est un processus humain, qui demande du temps et de la persévérance. Bienvenue chez les humains.
Pensez-vous que cette perte de compétences soit réversible ? Et si oui, par quels moyens ?
En physique, rien n’est vraiment réversible dès qu’on s’éloigne de l’équilibre. Et exclure la vie de cet équilibre, c’est ce que fait tout projet qui sacrifie la liberté ou le monde vivant – qu’il soit technoprogressiste, transhumaniste ou même « vert ».
Pourtant, il reste possible de préserver assez de savoir-faire pour construire un avenir vivable. Concrètement ? Soutenir ceux qui résistent encore, documenter les pratiques, transmettre les gestes, partager les outils. Et aller partout en parler – honnêtement, sans marketing.
Nous ne pourrons pas tout réparer. Mais nous pouvons encore apprendre, transmettre et semer des graines d’autonomie.
Un mot de la fin ?
Nous pourrions être ce qu’on appelle un « taxon Lazare », une expression empruntée à la paléontologie pour désigner des espèces que l’on croyait disparues, mais qui réapparaissent plus tard, contre toute attente. On annonce régulièrement notre fin – notre disparition culturelle, politique ou intellectuelle – mais, pour reprendre les mots de Mark Twain, ces annonces sont toujours encore exagérées.
Nous évoluons aujourd’hui dans un monde saturé de messages, de données, de promesses vides. Un univers où règne le vacarme – ou, comme l’a si bien formulé William Shakespeare, « tant de bruit pour rien ». Dans ce contexte, ce témoignage peut paraître décalé, voire absurde, surtout dans une société où le progrès se justifie par lui-même – on le promeut parce qu’il progresse, la nouveauté parce qu’elle est nouvelle, dans un rythme effréné, électrifié, vert et automatique. C’est une logique où l’on célèbre une chose pour elle-même, sans jamais se demander à qui elle profite, ni ce qu’elle remplace, où est son âme vis-à-vis de la nôtre. Et cela, avec parfois un cynisme impressionnant : « N’est-ce pas réjouissant ? » semble-t-on faire dire à l’enfant du Congo contraint à l’extraction du cobalt ou l’arthropode des grands fonds, à l’habitat détruit pour nos batteries.
Quand on regarde l’histoire – ancienne comme récente –, on voit que les pédagogies orientées vers le bien commun, vers la coopération et l’émancipation, n’ont souvent eu aucun poids face aux logiques de pouvoir, de profit et de domination, même lorsque ces dernières nous mènent collectivement à la ruine. Alors, que nous reste-t-il ? La parole entre semblables. Comme il y a 65 millions d’années, lorsque les grands dinosaures dominaient le monde, nous autres mammifères – petits, discrets, résistants – étions déjà là. Et nous apprenions à vivre à l’ombre des géants. Il est donc naturel que nous parlions notre langue, à ceux qui nous ressemblent, que nous partagions nos doutes, nos espoirs, nos pratiques, notre regard.
Je reçois avec joie tout message d’amour ou d’écho à cette tentative lucidité et – j’espère – de poésie.
Quant à l’action, vous êtes les plus bienvenus du monde au Cours de la Reconquête (voir encadré). Et plus ensuite, si entente.
A propos :
Pascal Cretton
Il parle d’autonomie comme d’une nécessité vitale, de technique comme d’un art partagé. Depuis les années 1990, Pascal Cretton développe le solaire thermique en Suisse romande – non pas comme un produit à vendre, mais comme une culture à transmettre. Cofondateur de Sebasol et actif chez Rhyner Energie Sarl, il a accompagné plus de 1300 projets. Son mot d’ordre : aider les gens à s’aider eux-mêmes.